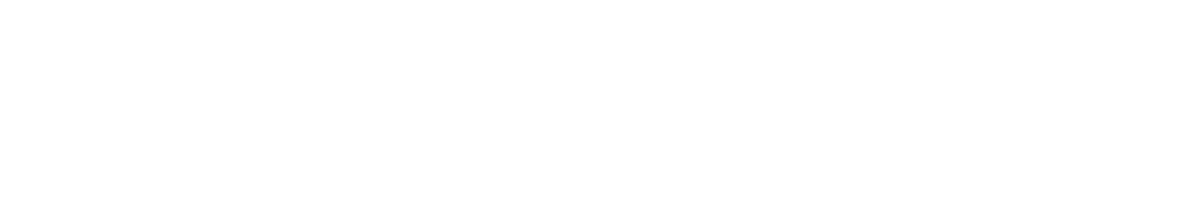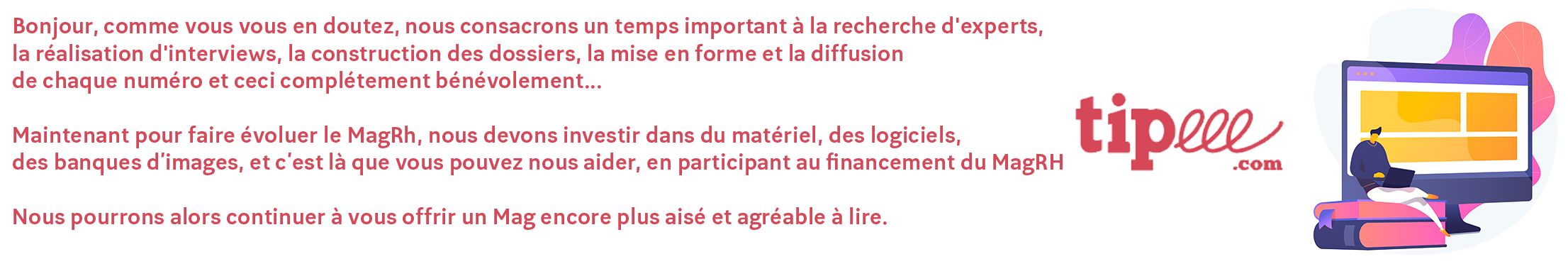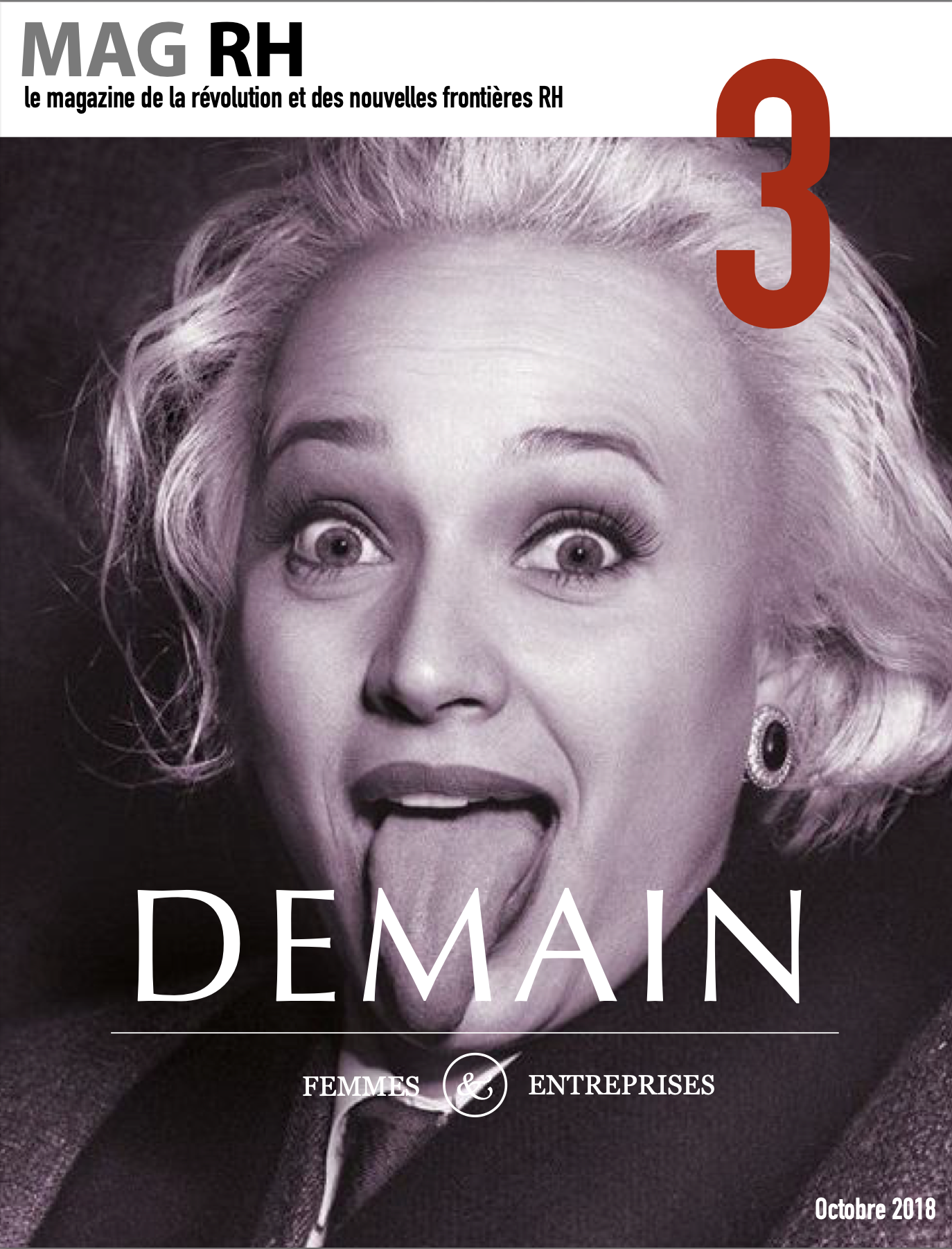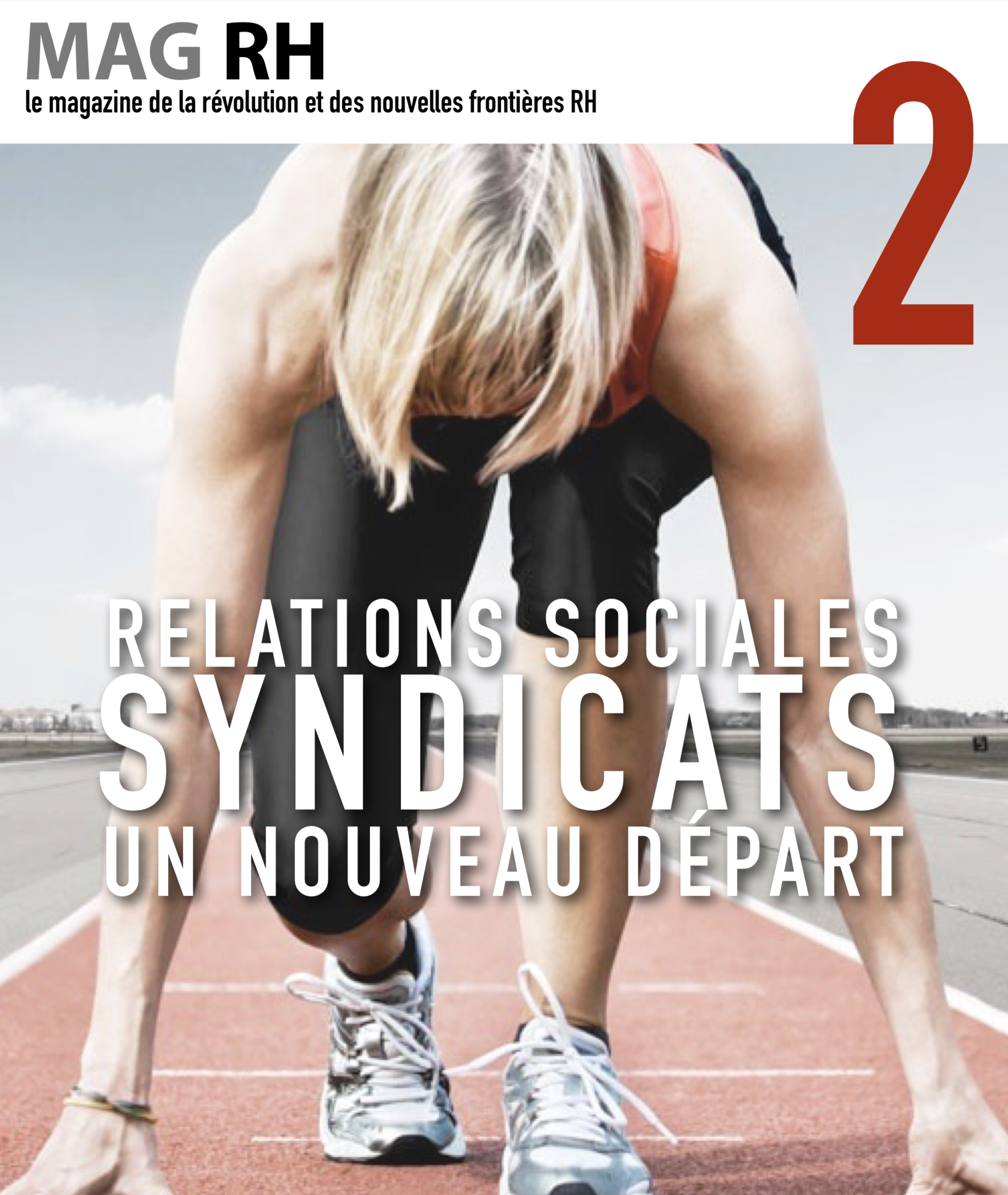Le besoin de quantifier chez l’homme est un besoin de longue date. La métrologie s’est d’ailleurs révélée bien avant la gestion des ressources humaines, lorsque l’on mesurait les crânes pour classer les espèces.
Dans la sphère RH, cela s’est traduit par l’apparition des démarches d’évaluation en entreprise, souvent matérialisées par l’entretien annuel d’évaluation…nous sommes dans la science de l’évaluation appelée docimologie. Il est utile de rappeler que cette démarche de «quantification» est apparue en réponse à la tertiarisation des métiers. Il existe des métiers, des fonctions, des postes, auxquels on peut rattacher des productions directes et des résultats. Evaluer (quantifier) le rendement et la productivité est donc tout à fait aisé. Mais quand les métiers ne produisent pas ou peu de valeur directe, immédiate, visible…
Comment fait-on pour s’assurer (se rassurer) que ces derniers sont «productifs» à leur façon ?
les entretiens annuels associés aux référentiels métier et compétences, agrégés à des objectifs globaux pour l’année, deviennent alors des outils «objectivant» les contributions. On n’a donc plus toujours le lien direct entre ce que fait la personne et ce qu’elle apporte et créée comme valeur pour le système.
Les systèmes d’informations permettent de capter, stocker et restituer de l’information. Cela sert donc à obtenir des représentations quantitatives voir qualitatives d’une population, d’un échantillon, d’un espace déterminé. Cela traite de l’état actuel, et passé. C’est utile, et surtout cela correspond à l’évolution sociétale. Les techniques quantitatives en sont évidemment le pendant et permettent de trouver le meilleur moyen de «quantifier», c’est-à-dire de donner une représentation mathématique d’une situation «réelle». La gestion des compétences, quant à elle, est un vaste domaine des RH qui couvre évidemment le processus de développement du professionnalisme de chaque collaborateur, mais aussi la gestion au sens «quantitatif» du terme. Référentiel – évaluation – positionnement et autres classifications structurent la discipline pour produire des «représentations» permettant de faire un état des lieux et de prendre des décisions. D’ailleurs cette systématisation de la mesure, de l’analyse et de la planification est une caractéristique centrale du paradigme managérial moderne.

Aujourd’hui, c’est plus largement l’Analytics RH (ou people Analytics) qui a le vent en poupe car évidemment la combinaison de la technologie et des mathématiques prend une place folle dans nos vies et celle des entreprises. Et comment résister quand on est un grand groupe qui se doit, ne serait-ce que pour ne pas passer pour une entreprise ringarde, d’avoir son système «à-tout-faire», dans tous les sens...qui permet surtout d’aller encore plus loin et de prédire. Mais que peut-on bien prédire en termes de gestion des compétences ? Les compétences dont nous aurons besoins demain ? les délais où certaines populations stratégiques vont ou risquent de partir ? La contradiction avec les algorithmes, c’est qu’ils ne peuvent mesurer que les comportements passés (même avec le machine learning, la «prédictibilité comportementale» reste relativement limitée) et que l’on s’en sert pour prendre des décisions… pour le futur. Tout l’intérêt d’une démarche de gestions des compétences étant justement de ne pas faire uniquement du «tendanciel» mais de décrypter/sentir/comprendre les ruptures et les ressources nécessaire à l’adaptation/la résilience/ mais surtout la réinvention de nouveaux modes de création de valeur.
Pourtant, La question qui nous vient, en cette période unique de crise sanitaire mondiale est : pourquoi n’a-t-on pas pu, avec toute l’intelligence que nous captons, stockons, restituons, prédire cette crise ? Les moyens ne manquent pas ! Mais derrière ces algorithmes, ces modèles mathématiques, se trouvent (encore pour l’instant), des êtres humains qui paramètrent, instruisent et guident le mécanisme d’apprentissage.
D’une manière générale, il y a des "règles d’or" de l’analyse statistique en sciences humaines :
- On ne peut rien dire d’un chiffre si on ignore comment il a été fabriqué ;
- Un seul chiffre ne saurait permettre de décrire ni de mesurer un phénomène social complexe ;
- Les chiffres ne parlent pas d’eux-mêmes, c’est nous qui les faisons parler.
Lorsque l’on mène un travail de recherche universitaire, la part méthodologique est très importante et un principe maintien notre cerveau en éveil : poser une question, instruire un sujet, organiser une recherche, c’est déjà produire, fermer, enfermer, réduire. C’est empêcher l’inouï d’apparaitre.
Les méthodes constructivistes sont donc souvent plus appréciées que les méthodes hypothético-déductives. Or, les méthodes statistiques sont précisément des hypothèses, des pré-modèles que l’on cherche à remplir sauf peut-être avec le deep learning, principe fondamental de l’intelligence artificielle, qui se nourrit en permanence et créé ses propres voies exploratoires.

Mais qu’est ce qui peut apparaitre «d’autre» dans une gestion de compétences quantitative et canalisée dans un S.I que ce qu’elle cherche à montrer ? que peut-il sortir d’innovant ? de nouveau ? d’autre ? de décalé ? quelle «belle surprise», étonnement, émerveillement est possible ?
Tout cela pour quoi ? que cherchons nous ? qu’est-ce qui est vraiment important pour la nature humaine, pour l’avenir commun que nous devons construire ?
Doit-on mettre encore plus les femmes et les hommes dans des cases, les séparer, les singulariser toujours plus, doit-on encore plus les découper, segmenter, triturer pour toujours mieux les comprendre ? Sacré Descartes, tu nous colles à la peau ! Quel étrange paradoxe de parler toujours plus de complexité et de développer des modèles de calculs toujours plus cartésiens ! Pensons complexe (ou simplexe en réalité) et arrêtons de réduire, enfermer le réel pour faire du compliqué.
Mais lorsque techniquement tout devient possible, la question est de savoir ce qui est souhaitable.
La question est plus éthique que technologique en réalité. Et puisqu’il s’agit de gestion des compétences, et que l’on sait que ces compétences sont «inhérentes» aux individus qui les mettent en œuvre, le sujet devient conceptuellement presque absurde. Tout cela coûte beaucoup d’argent, impose une empreinte carbone extrêmement élevée (data center) pour, finalement, produire quoi comme valeur-ajoutée ?
La problématique de la gestion des compétences pourrait alors s’«essentialiser» (sans devenir simpliste) : comment garder les personnes qui détiennent les compétences ? Comment capter et instruire l’organisation (Knowledge management) ?
Les réponses possibles à ces questions se trouvent plus dans les dimensions psychologiques du rapport au travail, dans les dimensions affectives du lien social, identitaires organisation (offre de sens ?), dans les phénomènes sociologiques et psychosociologiques qui sous-tendent les principes d’une organisation au sens du vivant, mais hélas, nos managers sont avant tout formés à être des gestionnaires d’équipes, RH peut-être, mais pas psychologues. Comment donc mieux utiliser les modèles mathématiques, les algorithmes, les processus de prévision sans leur déléguer ce qui reste magique dans l’art du «faire naître» (un potentiel, une compétence, un talent).
Pour conclure, nous posons une autre question qui taraude tous les chefs d’entreprise : celle du rapport coût-bénéfice de toute démarche engagée.
L’argent et le temps dépensés par toutes les parties de l’amont à l’aval pour penser, développer, tester, déployer, former, administrer, entretenir et faire vivre une gestion des compétences sont-ils en rapport avec les bénéfices apportés ? Deloitte USA mis fin il y a quelques années aux démarches d’évaluations individuelles, ayant calculé que sur son seul territoire américain, les coûts globaux (directs et indirects) de cette démarche animée et réalisée toute l’année représentaient environ deux milliards de dollars pour l’entreprise.
Nous terminerons avec cette citation de Mark Twain : "Il y a 3 grands types de mensonges : les mensonges, les gros mensonges et les statistiques".