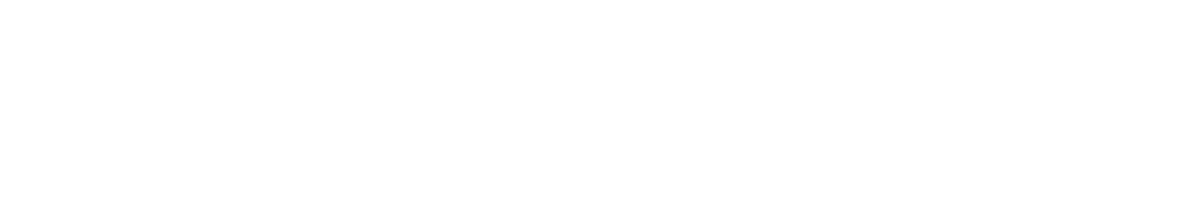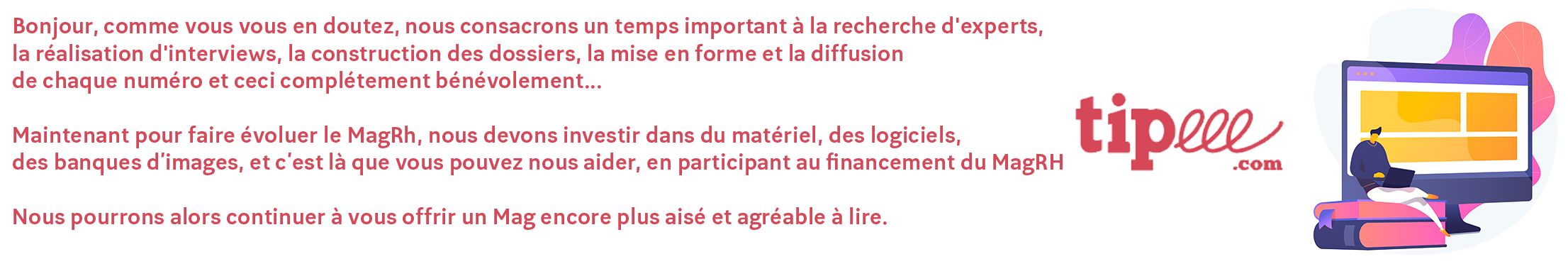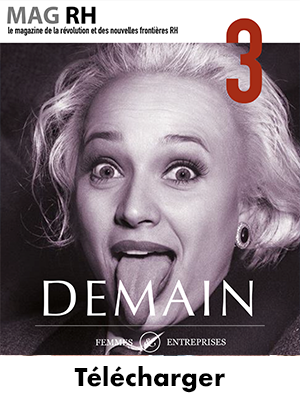L'évolution de la gestion des ressources humaines conduit à considérer : non pas que les hommes “sont” des ressources – c’est à dire qu’on peut les traiter comme des choses –, mais qu’ils “ont” des ressources ; et qu’il faut les convaincre d’orienter ces ressources au service de l’entreprise, de la manière la plus adéquate possible, dans des conditions de temps et de lieu définies, dans un contexte et des environnements circonstanciés.
La première notion qui vient à l’esprit, lorsqu’on parle de ressource humaine, est la compétence, puisqu’elle est condition nécessaire – et non suffisante – de la performance. La vocation originelle de la fonction RH est en effet de fournir, maintenir et accompagner, en quantité et en qualité, les besoins en compétence d’une organisation autour d’un projet, pour satisfaire à la totalité des missions, objectifs et tâches nécessaires.
Il fut un temps où il faisait bon être un « professionnel » ; puis il a fallu devenir un « haut potentiel » ; aujourd’hui on ne parle que des « talents »… ainsi vont les modes. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en tout état de cause aucun vocabulaire employé ne saurait faire l’impasse sur la « compétence » !
Quelques remarques élémentaires s’imposent tout d’abord, car en France nous avons trop tendance à assimiler la compétence : d’une part au diplôme ; d’autre part à la fameuse trilogie savoir/savoir-faire/savoir être.
Le diplôme : un atavisme aristocratique
Le diplôme ne garantit – au mieux ! – qu’une formation initiale, et il faut vraiment vivre dans un vieux pays de réseaux aristocratiques et de privilèges pour lui accorder du crédit indépendamment de la valeur réelle de la personne qui le possède. Si l’on observe bien, en effet, il est aisé de comprendre que les « diplômés » sont les « biens nés » de l’ancien régime, et que l’énoncé du « titre » vaut finalement bien la particule ! Ce n’est plus une question de chapeaux, mais de tournure d’esprit ; qu’importe : l’agiter devant soi en faisant des courbettes ouvre bien des portes… mais ne donne pas un gage de compétence effective.
Sans doute ces propos font-ils grincer quelques dents : c’est qu’il faut bien s’entendre sur le terme de compétence. Revenons donc sur le savoir/savoir-faire/savoir être. Ce n’est pas que cette trilogie soit sans rapport avec la compétence : elle en touche plusieurs aspects ; c’est plutôt qu’elle rejette dans l’opacité le point névralgique de ce qui la constitue, en maintenant à l’esprit plusieurs confusions :
La confusion entre
compétence et connaissance :
avoir lu « la natation en dix leçons »
n’apprend pas à nager
La compétence ne saurait se résoudre à la seule détention de connaissances ; elle implique une performance pratique que seule l’expérience permet d’acquérir. Quels que soient le métier et le domaine – qu’il soit technique ou qu’il relève d’une des professions dites « du savoir » – la distinction entre les connaissances théoriques et les performances pratiques demeure très importante.
S’il faut d’un certain coté privilégier l’expérience sur la connaissance, ce n’est pas sans raison : c’est bien l’expérience qui permet en effet, par la mise en œuvre répétée d’actions professionnelles instaurant une disposition permanente, d’effectuer un travail avec facilité et pertinence, d’en mesurer et contrôler les divers contextes et environnements. Le savoir-faire permet indubitablement une nécessaire et importante économie de la réflexion : nous pouvons accomplir des tâches sans reproduire à chaque fois l’itinéraire intellectuel qui serait nécessaire à son explicitation, à sa justification, à son argumentation.
La confusion entre
compétence et maîtrise technique :
répéter à la perfection les gestes de la brasse
ne suffit pas à nager loin et vite
Il nous faut nous garder d’un autre excès : à travers la cristallisation de l’expérience en habitudes, un professionnel peut devenir moins conscient de la façon dont il travaille. Le savoir-faire devient alors répétition ; l’habitude empêche la compétence de s’exprimer et de se réaliser pleinement dans un dialogue avec les autres et dans une recherche constante des adaptations à réaliser.
Il est communément constatable que dominer une activité, effectuer un travail avec grande expérience, conduit souvent à ne plus s’interroger sur ses difficultés, à ne plus observer le contexte où il s’exécute, à négliger les évolutions d’environnements qui en conditionnent en partie le succès. On comprend mal les problèmes rencontrés par les autres – collaborateurs, partenaires, clients, fournisseurs – pour aborder le même travail, et l’on évalue difficilement les évolutions qu’il conviendrait éventuellement de prendre en compte. L’absence de tout questionnement, de toute remise en cause devient alors le frein principal à la dynamique d’innovation qui fait normalement partie du professionnalisme attendu.
Il est frappant de constater à quel point des années de pratique « pure », si elles ont pu permettre – du moins dans la plupart des cas – d’acquérir une certaine expérience de terrain, ont néanmoins fait perdre, peu à peu, la conscience des connaissances qui en sous-tendent la véritable maîtrise. La pauvreté culturelle et le manque de réactivité qui en résultent sont parfois déconcertants, même chez des gens qui possédaient, au départ, un très haut niveau de connaissance.
Sans développement de l’action, la connaissance demeure inutile ; sans développement de la connaissance, l’action devient stéréotypée et vite stérile. Si les deux efforts sont inverses, et réclament des qualités presque contraires, il n’en reste pas moins qu’ils maintiennent des exigences respectives tout à fait propices à la créativité et à l’innovation.
La confusion entre
compétence et comportement :
s’épuiser en efforts constants ne permet
pas au nageur d’arriver le premier
Certes, la compétence s’appuie sur des connaissances, requiert une maîtrise technique et suppose de savoir s’y prendre avec les autres et avec soi-même ! Mais tout ceci ne nous donne pas encore la notion la plus fondamentale, plus au cœur de ce qu’est la compétence. Elle repose toute entière, en fait, sur une adéquation, à un moment donné du temps et un lieu particulier de l’espace, entre une capacité concrète de mise en œuvre et un besoin particulier et circonstancié.
La nature du comportement, tout comme celle du tempérament, est sans nul doute une composante importante de la compétence. Mais ce que l’on a coutume de désigner sous le nom de « savoir être » fait rarement l’objet d’un apprentissage professionnel. Et si certaines formations ou certaines actions de coaching tentent d’en élucider les ressorts individuels, elles ont la fâcheuse tendance à tourner davantage à la psychothérapie initiatique qu’à l’acquisition d’une véritable maîtrise. Non qu’un travail sur notre psychologie ne soit pas utile, mais il est insuffisant : l’introspection doit également trouver son terme et son dépassement dans la relation aux autres. Entrer en soi-même est à la portée de beaucoup ; en sortir pour véritablement « rencontrer » l’autre est plus rare. Fonder une collaboration effective, sur la base de cette rencontre, en établissant de façon partagée les règles de son développement, est rarissime.
La compétence relationnelle ne repose donc pas d’abord sur un comportementalisme piloté par les circonstances, les contextes et les environnements, ni sur l’individualisme d’une image valorisante. Elle s’appuie sur une démarche volontaire de construction d’une collaboration et d’un partage que l’on développe avec soin au fil du temps, au sein d’un collectif de travail.
Une étymologie inspirante
Le mot même de « compétence » vient d’un composé latin qui signifie : « ce qui convient à…, ce qui va bien… ». En ce sens, par exemple, nous dirons d’un costume qu’il nous est « compétent » s’il est à notre taille et qu’il nous « tombe » bien, compte tenu de notre corpulence, de notre complexion et de notre état du moment. L’idéal serait même de pouvoir le retailler régulièrement. Mais s’il ne nous va pas, alors ni la richesse de sa matière, ni son prix, ni sa marque (son diplôme en quelque sorte), ni le fait qu’il va si bien à un autre… ne pourront nous sauver du ridicule !
C’est l’incompétence qui est motrice
Autrement dit, on ne peut pas dire que quelqu’un est compétent comme si c’était une vérité ou une qualité « en-soi ». Chacun évolue sans cesse de l’incompétence à la compétence en s’adaptant à une situation concrète.
Sous ce rapport, nous pourrions dire que, paradoxalement, ce n’est pas la compétence qui est le principal moteur d’un professionnel, mais bien l’incompétence : elle est le facteur qui motive et engendre l’évolution et l’adaptation. Et la valeur de quelqu’un – dans la si difficile question du « choix des hommes », par exemple – se mesure davantage à la manière dont il réagit à ses incompétences, qu’aux compétences acquises dont il peut faire montre.
La compétence repose ainsi sur une maîtrise des relations entre les causes et les effets d’une action, qui en garantit la reproductibilité et le perfectionnement dans le temps. Les causes en question recouvrent évidemment des compétences techniques, mais aussi financières, humaines, organisationnelles, conjoncturelles et contextuelles. Autrement dit, l’exercice d’une compétence repose sur un professionnalisme avéré, c’est-à-dire conscient de lui-même, exprimable, justifiable, communicable.
Et les fameuses « compétences clés » ?
On ne le répètera jamais assez : les compétences clés ne se décrètent pas, elles s’élaborent et se définissent dans un aller-retour fécond entre les orientations, la stratégie de l’entreprise et l’expérience des professionnels.
En effet, la notion de « compétences clés » ne relève pas d’une spécialisation accrue dans un domaine particulier – sauf à parler de compétence strictement technique –, définie par l’entreprise en une formule stéréotypée et immuable ; mais elle est au service d’une performance qui se construit de la synergie de multiples dimensions (pour donner une image : ce sont quelques passe-partout et non un gros trousseau de clés… qui finit toujours par trouer les poches). La spécialisation à outrance – hormis les cas de compétences hyper techniques, encore une fois – a toujours pour effet de privilégier un aspect des choses aux dépens des autres, créant des disproportions néfastes à la performance ; or de plus en plus, c’est la capacité à saisir un problème dans son ensemble et à le traiter sous ses différents biais, en fonction de la position et du rôle propre d’un professionnel, qui garantit une réactivité appropriée.
Peut-être même n’y a-t-il qu’une « compétence « clé » : celle qui, comme son nom l’indique, « ouvre » les autres – consiste à mettre en œuvre les connaissances, les actions et les attitudes qui permettent une telle adaptation en temps réel. C’est une méta-compétence, en quelque sorte, pour employer un jargon de spécialiste : une compétence servant à demeurer compétent et à développer ses potentiels.
Au sur-homme saturé, sans doute vaut-il mieux préférer « l’honnête homme » responsable, c’est à dire celui qui est suffisamment conscient de ses défauts, manques et carences pour tâcher de s’adapter au mieux à l’objectif qu’il vise, en faisant preuve d’imagination et de créativité pour compenser les défauts, manques et carences en question.
Pas de compétence durable
sans management réel
En tant que dirigeant ou manager, il faut y penser lorsque nous inaugurons une collaboration : nous avons élaboré une proposition bien définie de la contribution que nous attendons, de notre coté. Mais c’est « quelqu’un » que nous recrutons ! Pas seulement une ressource pour satisfaire les besoins en question ! Voilà une problématique originale, souvent négligée par les recruteurs : choisir « quelqu’un » pour répondre à « quelque chose » est un acte qui introduit toujours de l’entropie dans l’entreprise. C’est passer d’un besoin d’objet – réalité matérielle, fonctionnelle, opérationnelle – au désir d’un sujet personnel : on introduit là du vivant, de l’organique, de la valeur humaine ; il s’immisce à ce point une intention qui dépasse largement le besoin froidement analysé. Ceci suppose évidemment de ne pas considérer les êtres humains comme des choses ou des consommables… mais de les mettre en situation de confiance, d’autonomie et de responsabilité.
Le management est l’établissement de règles claires et communes qui définissent les rapports et les comportements que sont censés développer des professionnels dans l’exercice de leurs activités respectives. Il établit une structure stable, capable de supporter les variations d’environnement et les adaptations organisationnelles nécessaires. Ces règles répondent à une formalisation explicite, permettant à chacun d’apprécier avec justesse sa marge de manœuvre, son pouvoir d’initiative et les limites de ses responsabilités.
Établir ces règles de telle sorte qu’elles ne formalisent ni trop ni trop peu les rapports et les comportements des individus et des équipes relève d’un art, parfois fort délicat. Trop de formalisation produit un effet inhibant et une passivité ; trop peu de formalisation conduit du flottement, de la démotivation et de l’insatisfaction. On pourrait presque dire que la problématique du management peut se réduire au fait de savoir ce qu’il faut formaliser et ce qu’il ne faut pas formaliser pour permettre à chacun et à tous d’exprimer pleinement… leurs compétences.