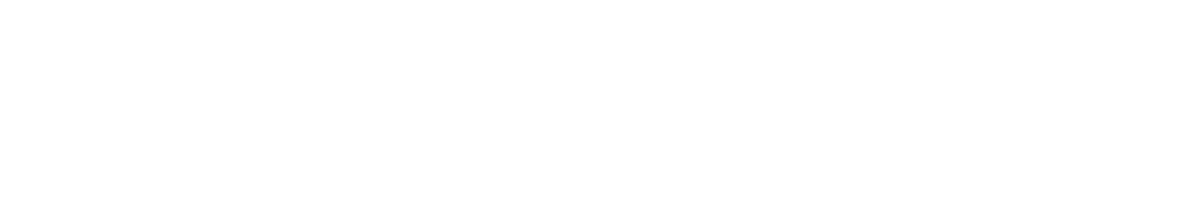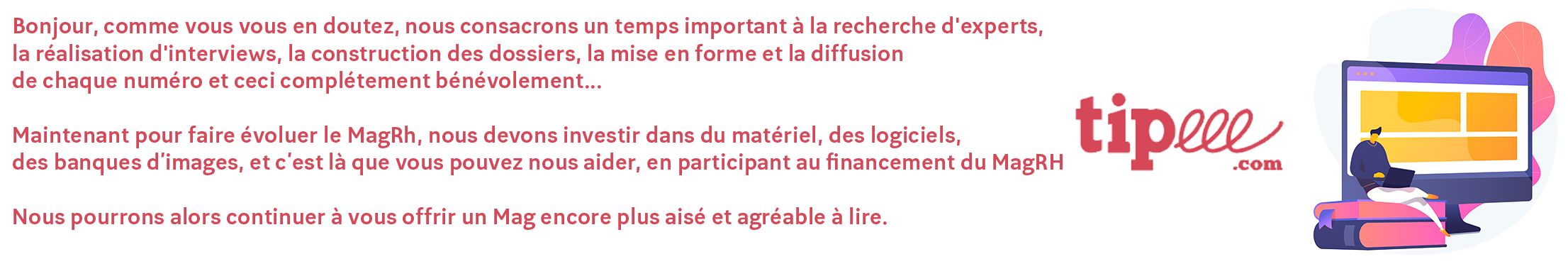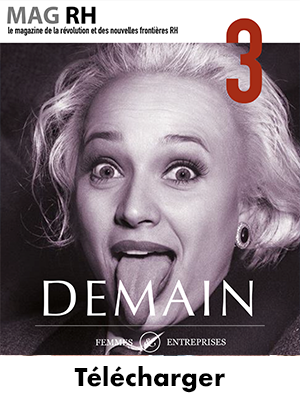Par Hubert LANDIER
L’irruption de la problématique relative à l’amélioration des conditions de travail peut être située en 1972, avec la grève des ouvriers de l’usine Renault du Mans. Et c’est l’année suivante qu’est créée l’ANACT. Du côté patronal, l’UIMM imagine les « équipes d’amélioration des conditions de travail ». Et c’est en 1982 que, sur une base paritaire, sera créé le CHSCT.
Cette problématique correspond, venant des syndicats, et plus particulièrement de la CFDT, à la conviction qu’aux revendications « quantitatives » (salaires, durée du travail) doivent s’ajouter, sinon se substituer, des revendications « qualitatives ». Autrement dit, le progrès social ne consiste pas seulement à obtenir une augmentation des salaires et une baisse de la durée du travail. Par exemple, il ne s’agit pas, ou il ne s’agit pas seulement, d’obtenir des « primes de poste » en faveur des travailleurs postés (3X8) mais de faire reculer le travail posté et, si ceci n’est pas possible, de l’aménager de façon à le rendre physiologiquement plus supportable compte tenu des rythmes circadiens qu’étudient les chronobiologistes.
Le mouvement en faveur de l’amélioration de conditions de travail débouchera des progrès substantiels en termes d’ergonomie des postes de travail, de valorisation des facteurs d’ambiance et d’aménagement des temps de travail. Ainsi :
- L’ergonomie permettra de modifier de réduire les TMS résultant de gestes répétitifs correspondant à des postes de travail mal conçus ;
- Les « bureaux paysagés » seront conçus comme une occasion de décloisonner l’entreprise et d’améliorer la communication interne ;
- Les « horaires libres » permettront à chacun d’adapter ses temps de travail à ses contraintes personnelles et de désengorger les transports en commun horizontaux (bus et métro) et verticaux (ascenseurs des tours de La Défense).
Certains syndicats (et notamment la CGT) craignent que ces mesures ne soient qu’un prétexte pour ne pas répondre aux « véritables revendications » des travailleurs. Il leur arrive même de tenter de s’opposer à leur mise en œuvre tout en prenant acte, à l’occasion, de leur aspect positif (ainsi, Henri Krasucki évoquant dans la V.O. « l’usine où c’est moins pire qu’ailleurs »).
L’amélioration des conditions de travail ne portera pas seulement sur les facteurs physiques mais également sur des facteurs psychologiques générateurs, notamment, de stress et de syndromes dépressifs. De là, on passera insensiblement à l’amélioration du bienêtre et des conditions de vie au travail2, voire au « bonheur au travail ». Il sera également question, dans une perspective reproduisant souvent l’idéologie New Age des années quatre-vingt, de « développement personnel ». Ce seront là autant de composantes de ce qu’on appellera, dans les années 1980, la « responsabilité sociale de l’entreprise ».
Cette idée de « bonheur au travail », qui va à l’encontre de la conception d’un travail nécessairement pénible et dont il faut donc réduire la durée (« ne pas perdre sa vie à la gagner ») suscite beaucoup d’enthousiasme militant. Elle pose néanmoins un certain nombre de problèmes et on peut ainsi la considérer avec trois regards différents : un regard naïf, un regard pragmatique et un regard cynique.
Le bonheur au travail expliqué aux enfants
La progression prudente du DRH d’une grande entreprise, casque en tête et accroché à des filins tendus à quinze mètres de haut entre deux séquoias dans les montagnes à l’est de Santa Cruz (en Californie) constitue un spectacle pittoresque. Il s’agissait, vers la fin des années 1980, d’un séminaire outdoors où les participants étaient ainsi invités à surmonter leur peur, à évaluer leurs capacités à affronter la situation et à mieux travailler en équipe en se sentant coresponsables de la sécurité des uns et des autres. D’autres, dans le même esprit, auront crapahuté dans le Ténéré, une grande compagnie d’assurance aura organisé un Codir sous la tente dans le sud algérien, un séminaire de direction se sera tenu sous un tipi dans le Nevada, ou encore, les managers d’un grand groupe hôtelier auront été conduits à plonger dans un simulateur reproduisant l’univers confiné d’un sous-marin. Dans l’ambiance New Age du début des années 1980, l’importance accordée au développement personnel aura ainsi conduit à des démarches qui font apparaître comme extrêmement ternes les démarches aujourd’hui proposées sur LinkedIn ou sur le programme de la Maison du Management.
L’objet en est le même : permettre aux managers d’expérimenter des situations nouvelles pour eux, créer un choc émotionnel débouchant sur une modification de leur comportement au travail, leur ouvrir l’esprit en les plongeant dans un contexte très différent de celui qui constituait leur routine. Le présupposé en est que le développement personnel débouche nécessairement sur une plus grande efficacité au travail. De là des propositions de programmes qui vont de l’initiation à la méditation aux ateliers philosophiques en passant par l’application de l’astrologie au management et par le témoignage de sportifs de haut niveau ou de militaires en retraite.
Parallèlement, l’offre s’étend de démarches visant à améliorer les « facteurs d’ambiance ». Des entreprises high tech ou des cabinets d’audit créent, à l’intention de salariés surchargés de travail, une conciergerie ou un jardin d’enfants. Elles mettent à leur disposition une salle de relaxation ou un numéro vert en cas de burnt out, voire un service de médiation conjugale. Ces services sont généralement très appréciés des intéressés. Il arrive même qu’ils suscitent de l’enthousiasme. Reste à s’interroger sur leur finalité, venant de leurs initiateurs. On en proposera trois :
- Améliorer, à un faible coût, l’image employeur et attirer ainsi, puis retenir, des « talents » volatiles que la finalité propre à l’entreprise laisse souvent indifférents,
- Chercher à renforcer l’engagement des salariés en leur présentant l’entreprise comme un lieu de « bonheur au travail ».
- Proposer, venant des prestataires, des offres innovantes, fondées sur une présentation de l’entreprise comme un lieu de vie épanouissant.
Développement personnel d’une part, souci du bien-être au travail et du bonheur des salariés de l’autre, appellent donc un jugement nuancé. Certes, les services d’une conciergerie peuvent être appréciables et la conférence d’un ancien chef d’état-major peut ne pas être dénuée d’intérêt. Les participants à un séminaire sur la relaxation au travail peuvent en revenir enthousiastes. Reste à chercher les raisons profondes qui se dissimulent derrière les bons sentiments mis en avant par les initiateurs de telles pratiques. Certes, le chef happyness manager peut être plein de bonne volonté et croire très sincèrement à l’intérêt de ce qu’il fait pour les salariés auxquels s’adressent ses services. Reste à savoir s’il n’est pas victime (inconsciente ou consentante) d’une entreprise de manipulation. Un peu d’esprit critique pourrait donc se révéler salutaire.
On comprend que les bénéficiaires soient plutôt satisfaits. Cela ne veut pas dire qu’ils soient nécessairement dupes des intentions qui se cachent derrière une façade humaniste de bon aloi. On comprend également les intentions qui animent les prestataires de tels programmes. Il s’agit pour eux de proposer des programmes « innovants » qui permettront à l’entreprise de pouvoir compter sur des salariés heureux et performants. Y croient-ils ? La question est à peu près aussi pertinente que de se demander si un cardinal d’ancien régime croyait en Dieu.
La manipulation des esprits s’orne volontiers de nobles sentiments et d’enthousiasmes naïfs. Car enfin, est-ce à l’entreprise de s’intéresser aux problèmes matrimoniaux des salariés qu’elle emploie ? On aura compris que le bonheur au travail, ainsi proclamé, peut coexister avec une pression accrue, à un développement du stress, à une consommation accrue d’analgésiques, et ainsi de suite. Une façade, autrement dit, qui dissimule les réalités moins glorieuses que révèlent parfois les audits de climat social lorsqu’ils sont bien faits.
Car enfin, si le bonheur au travail, compte tenu de telles pratiques, était si réel, comment se fait-il que les problèmes de stress soient devenus si fréquents ? Et si les salariés étaient si heureux, comment se fait-il que le désengagement, à défaut de conflits ouverts, soit en constante progression ? La problématique du bonheur au travail ne serait-elle pas la manifestation d’un déni patronal devant des problèmes autrement plus lourds ? L’imagerie de la start up performante et heureuse, de la bande de copains avec café gratuit et babyfoot dans l’entrée, avec un patron convivial et décontracté, qui tutoie tout le monde, ne correspond pas nécessairement à la réalité. Il s’agit là d’un conte à l’intention des enfants sages.
L’approche pragmatique : un objet de négociation
Traditionnellement, la négociation sociale, notamment au niveau de l’entreprise, portait essentiellement sur les salaires et sur la durée du travail. Or, peu à peu, ces deux thèmes ont débouché sur une impasse :
- Pendant longtemps, l’inflation constituait le prétexte à une négociation annuelle visant à remettre les salaires à niveau et, si la conjoncture économique le permettait (selon l’employeur), à accroître (un peu) leur pouvoir d’achat. Cela se traduisait par des pourcentages d’autant plus élevés que la hausse des prix était elle-même plus élevée. L’enjeu était donc important, même si la hausse des prix aboutissait par la suite à une disparition de l’avantage obtenu au terme de « dures négociations ». Or, à partir du moment où l’inflation a quasiment disparu, les hausses salariales deviennent infimes et l’enjeu se trouve réduit d’autant.
- De même, la durée du travail a constitué depuis le XIXe siècle, l’autre grande revendication ouvrière. Et donc, elle n’a cessé de se réduire, que ce soit sa durée hebdomadaire ou sa durée annuelle. Or, depuis la loi sur les 35 heures, il n’y a plus rien à négocier, sinon de simples aménagements. Là aussi, il n’y a plus grand chose, ni à « gratter », ni à concéder. Pour reprendre l’expression de feu le secrétaire général de la CGT-FO, André Bergeron, il n’y a plus de « grain à moudre ».
Il a donc fallu rechercher d’autres thèmes afin de nourrir le « dialogue social » et c’est comme cela que l’amélioration des conditions de travail, entendue dans un sens très large, en est venue à meubler les négociations. Le thème répond en effet, de part et d’autre, aux préoccupations en présence :
- Pour les DRH, il permet d’afficher leur volonté d’avancer dans le sens du « progrès social » et de faire vivre les relations sociales à un coût moins élevé que ne le serait une augmentation conséquente des salaires - dont le bienfait serait du reste vite oublié ;
- Pour les négociateurs syndicaux, le thème de l’amélioration des conditions de travail permet de faire état des résultats positifs de leur action sachant que leurs marges de négociation en matière de salaires et de temps de travail sont souvent extrêmement limitées ;
- Pour les uns et pour les autres, enfin, le mieux vivre au travail répond à une évolution des attentes, venant des salariés. Il s’agit de plus en plus pour eux, pour autant qu’ils peuvent se le permettre, d’éviter de perdre sa vie à la gagner en trouvant de l’agrément à son travail.
Ainsi, l’on ne peut qu’être frappé par la créativité que manifestent les négociations d’entreprise dès lors qu’elles investissent des champs nouveaux répondant à une visée de progrès social à coût économique zéro ou limité, dès lors que la conjoncture ne permet plus la générosité qui semblait aller de soi à l’époque des « Trente glorieuses ». Cette créativité du dialogue social, loin des proclamations officielles, se manifeste à deux niveaux complémentaires :
- D’une part, le dialogue social institutionnel, dans le cadre des instances de négociation prévues à cet effet et qui visent à trouver des compromis acceptables pour chacune des parties en présence en se situant au-delà des thèmes traditionnels (hausse des salaires et baisse de la durée du travail) devenus inopérants ;
- D’autre part, le dialogue informel, qualifié parfois de dialogue professionnel, tel qu’il passe par les relations quotidiennes entre les membres de l’équipe et le manager ; il s’agit alors de favoriser l’expression de chacun, de prendre en compte les suggestions et de réduire autant que faire se peut les « irritants sociaux » qui viennent compromettre la vie quotidienne au travail.
Ces irritants sociaux concernent toutes sortes de dysfonctionnements laissés souvent sans solution mais qui contribuent à une dégradation des conditions de travail. Or, ces irritants vont évidemment à l’encontre de la qualité des relations avec le management de l’entreprise, contribuent à un approfondissement du désengagement des salariés et à l’apparition de tensions, et finalement à une dégradation de la qualité de l’ambiance de travail. A défaut de souscrire aux objectifs prétentieux mis en avant par les prestataires de solutions visant à instituer le « bonheur au travail », l’entreprise peut déjà réparer les douches qui fuient, changer le néon qui clignote et répondre aux questions que se posent les salariés sur ce que sera leur situation d’ici deux ans compte tenu de ce qu’ils entendent dire à propos des difficultés de la situation économique de l’entreprise.
Les arrière-pensées du bonheur au travail
Si les dirigeants de l’entreprise investissent dans le champ de la qualité de vie au travail, voire dans le bonheur au travail, c’est, au-delà des intentions généreuses et humanistes qu’ils mettent en avant, telles qu’elles animent effectivement certains d’entre eux, qu’ils y trouvent un intérêt, ou plutôt que l’entreprise y trouve un intérêt, et derrière elle les investisseurs. Cet intérêt peut s’analyser de la façon suivante :
- Répondre, au moindre coût, aux attentes des salariés,
- Nourrir le dialogue social en tant que mode de traitement des tensions,
- Développer l’engagement des salariés,
- Améliorer l’efficacité collective, et donc la performance de l’entreprise,
- Améliorer l’image employeur et donc attirer et conserver les talents.
Si l’on exclut le bric-à-brac de certains intervenants, souvent affublés de dénominations prétentieuses (« entreprise libérée », « entreprise agile », « entreprise de soi », « learning organization, » etc.), les initiatives en termes de qualité de vie au travail représentent indéniablement une contribution au progrès social. On ne peut que s’en féliciter. Mais il convient immédiatement de formuler certaines remarques :
- il s’agit souvent de la compensation d’une sujétion imposée ; par exemple, la création d’une conciergerie ne saurait dissimuler, quand elle se confirme, l’accroissement des exigences à l’égard des salariés ; il s’agit donc d’une mesure compensatoire, susceptible de dissimuler la réalité d’une dégradation des conditions de vie au travail ;
- une telle démarche peut présenter un caractère cosmétique : éviter les risques sociaux au moindre coût en s’abstenant d’aborder « les sujets qui fâchent » et créer artificiellement une sorte d’émulation positive ;
- et surtout, l’objectif de performance demanderait à être précisé : s’agit-il de performance globale, intégrant les intérêts des différentes parties prenantes de l’entreprise, parmi lesquelles les salariés, ou s’agit-il de performance actionnariale, valorisant d’abord, sinon exclusivement, l’intérêt des investisseurs ?
Si tel est visiblement le cas, on comprend que les syndicats y voient une manipulation au détriment des salariés et que ceux-ci persistent dans leur attitude de désengagement. Il conviendrait en effet, pour éviter ce piège, qu’ils soient véritablement associés au devenir de l’entreprise et à sa « raison d’être », pour reprendre les termes ambigus de la Loi PACTE. Il faudrait, autrement dit, définir les modalités de participation des différentes parties constitutives de l’entreprise, et donc les salariés – à la définition de ce qui pourrait constituer son « bien commun ».
A cette condition seulement, la thématique de la qualité de vie au travail pourrait être autre chose qu’une sucette proposée aux enfants pour qu’ils restent sages. Et il serait logique alors que l’investissement qu’elle représente figure aux actifs du bilan au même titre que les investissements matériels, et ceci dans une optique de performance globale répondant aux attentes de l’ensemble des parties prenantes et non plus seulement de l’une d’entre elles.