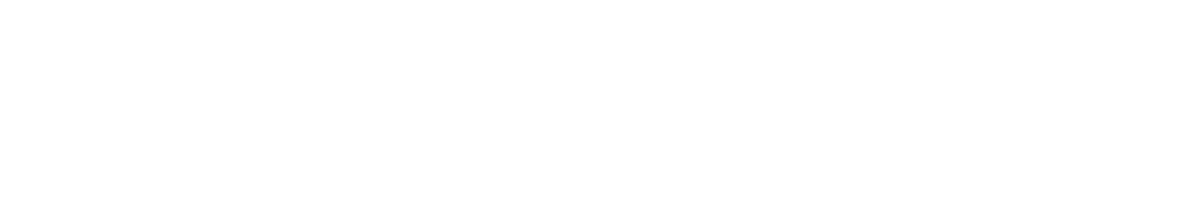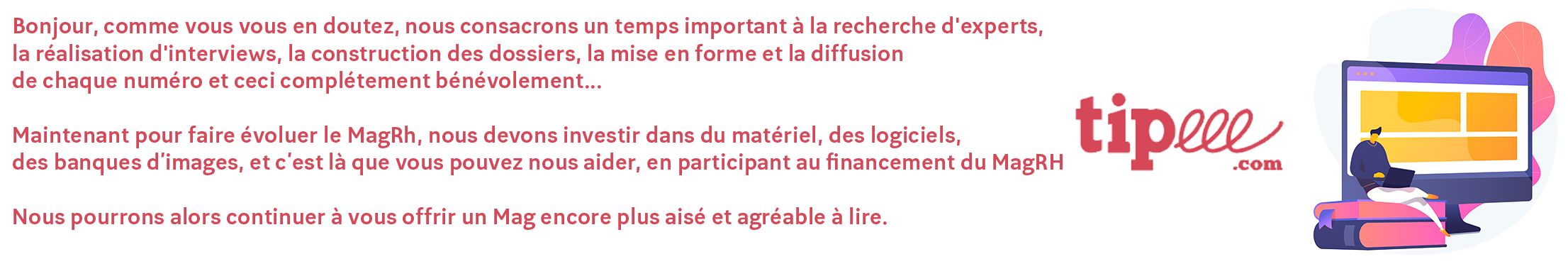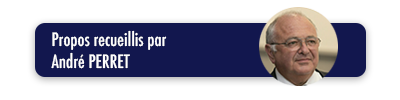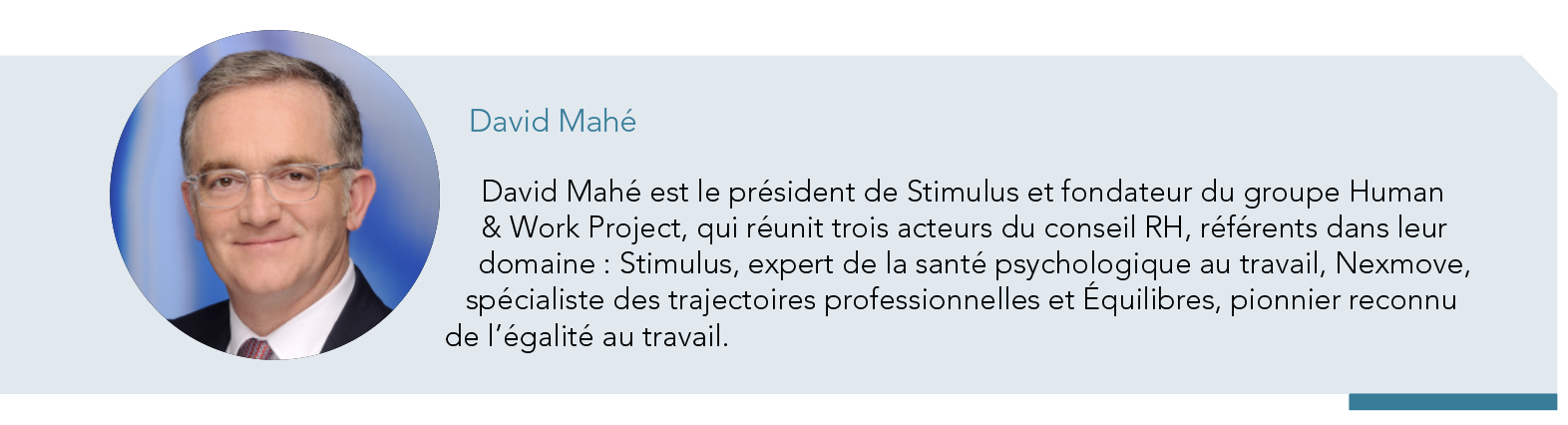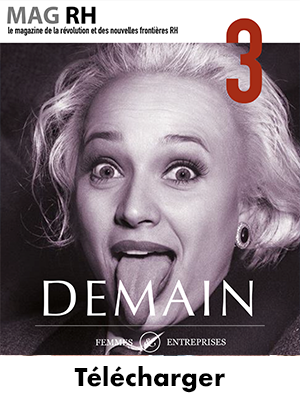Par Christophe VIGNON,
Ce titre est provocateur. Mon propos ne consiste pas à dire qu’il faut rendre les gens malheureux au travail. Il me semble toutefois illusoire de vouloir rendre les gens heureux à leur insu, 1984 nous guette. C’est le risque que nous courons en GRH à vouloir processer la quête du bien-être. Les personnes avec qui Agnès Vandevelde Rougale (2017) a travaillé, tant en Irlande qu’en France, semblaient souffrir davantage après être entrées dans le processus de gestion du harcèlement, que du seul fait d’avoir été harcelées. En ce sens, les normalisations langagières obèrent la possibilité de subjectivation par les membres des organisations, notamment lorsqu’ils sont en souffrance.
Le bien-être est aujourd’hui à la mode. Quel DRH ne rêve-t-il pas de voir les membres de son organisation épanouis et heureux. Pourtant, les données chiffrées sur l’état de la santé mentale dans les entreprises sont plutôt inquiétantes. Nous pouvons faire l’hypothèse que si actuellement le discours managérial valorise tant le bien-être c’est que le mal-être va croissant. Faisons d’abord un rapide état des lieux avant de voir en quoi l’intériorisation du bien-être constitue une réponse illusoire à ce phénomène. Déplacer la focale du psychique vers le social peut alors constituer une façon plus humaine d’aborder la question du mal-être.
Un constat inquiétant
La santé psychique des salariés se détériore partout en Europe. Une note du Ministère Fédéral du Travail Allemand publiée fin mars 2019 indique que le nombre de jours de maladie dus à des problèmes psychologiques a plus que doublé au cours des dix dernières années, passant d’environ 48 millions (2007) à 107 millions (2017). Les coûts économiques des temps d’arrêt, constitués essentiellement par le nombre de jours de maladie et le nombre de départs prématurés à la retraite, ont presque triplé, passant de 12,4 milliards d’euros à 33,9 milliards d’euros au cours de la même période. Le gouvernement fédéral considère les employeurs comme les premiers responsables car beaucoup d’entre eux usent leurs employés en les faisant travailler au-delà de leurs limites. Il est certain que la précarisation des relations d’emploi contribue à cette dégradation de la santé mentale. Ce gouvernement semble toutefois oublier que les lois Hartz sur la flexibilisation du travail favorisent de tels comportements.
En Grande-Bretagne le constat est proche, le National Health Service fait état de 31 % d’arrêts de travail prescrits pour des problèmes de santé mentale. Pourtant, les Anglais, tout comme les Allemands, consomment 4 fois moins d’antidépresseurs que les français. En effet, si les statistiques apparaissent un peu plus favorables chez nous c’est parce le problème se résout davantage à coup d’antidépresseurs et d’anxioloxytiques. Nous en sommes ainsi les deuxièmes plus grands consommateurs, juste après l’Espagne. Toutefois, la santé mentale constitue quand même chez-nous le deuxième motif d’arrêt maladie, notamment pour dépression. La surcharge de travail, l’insatisfaction liée à la rémunération, la mauvaise ambiance au travail ou encore la mauvaise organisation constituent plus de la moitié des causes identifiées de ces arrêts. Les cas de dépression, d’anxiété ou de burn-out en lien avec le travail sont en augmentation. Cette souffrance psychique a également des effets moins visibles, car la causalité est moins directe, sur les corps : troubles du sommeil, névralgies, lumbago, maux de tête.
Un autre effet identifié de la souffrance au travail est l’augmentation de l’absentéisme. Le baromètre Ayming-AG2R La Mondiale publié en septembre 20181 montre ainsi qu’il est en progression régulière ces dernières années et atteint en 2017 4,72 % des heures de travail. Si un tiers de celui-ci semble incompressible, une étude de l’ISEOR2 montre que l’évolution des modes de management permettrait d’en éviter une très grande part. Toutefois, comme son coût n’est pas comptabilisé, les plus de 100 milliards d’euros annuel qu’il représente restent cachés.
Malgré ce constat le syndrome du bien-être (Cederström & Spicer, 2016) tend à s’imposer dans notre société. Ce syndrome conduit à intérioriser une norme du bonheur qui déconnecte la santé mentale de son contexte socio-politique et conduit à l’intériorisation de la norme du bien-être. La progression du mal-être contribue à la popularité du discours sur le bien-être. Ce discours fait écho au développement de la psychologie positive et à sa diffusion dans le monde du management (Cabanas & Illouz, 2018). Cela conduit par exemple, dans certaines organisations, des dirigeants à organiser des séances de massage, de méditation ou de yoga en espérant ainsi réduire le mal-être. Ce faisant ils n’interviennent pas sur les problèmes organisationnels de fond générateurs de souffrance.
L’intériorisation de la norme du bien-être
Au cours de l’automne 2018 le contrat d’alternance d’une de mes étudiantes en Master RH a été rompu par l’entreprise pendant la période d’essai après une semaine de présence en entreprise sans que l’étudiante n’ait perçu de signe avant-coureur de cette rupture. Lorsque je l’ai reçue quelques jours plus tard pour parler de cela et voir quelle suite donner à son année académique elle était choquée et ne comprenait pas le sens de cet échec personnel. A un moment de notre entretien, alors que cela faisait bien une heure que nous discutions, je lui ai dit qu’elle avait le droit de penser que la DRH de l’entreprise (qui était sa tutrice) était une « grosse conne ». D’abord elle fut surprise que j’utilise de tels mots puis elle s’est détendue comme libérée d’une charge émotionnelle. Elle n’était plus coupable à ses propres yeux et l’entreprise pouvait s’être trompée et avoir tort. A titre personnel je ne connais aucunement cette DRH et son degré de connerie a peu à voir avec l’histoire. Ce qui importe c’est que nos étudiants sont dans un tel conditionnement à l’idéologie de la performance des organisations pour lesquelles ils travaillent qu’ils en effacent toute leur subjectivité. Ils ne parviennent plus à s’autoriser de raisonner, dans leur cadre professionnel, autrement qu’en termes de performance économique. De plus, l’idéologisation du bonheur ne leur laisse pas d’espace pour exprimer leur mal être, leurs angoisses. Or, l’angoisse et la souffrance sont inhérentes à la condition humaine. La norme du bien-être les rendrait illégitimes.
Le discours de la psychologie positive déconnecte le mal être du social, comme s’il n’y avait pas d’effets du réel auquel chacun est confronté dans son travail. L’individualisation croissante des évaluations, la flexibilisation accrue des organisations et la disparition des collectifs au travail sont porteuses d’insécurité personnelle. Elles créent à la fois la nécessité et l’illusion de développer un moi fort pour faire face au quotidien. La personne se trouve alors considérée comme seule responsable de ses malheurs : chômage, exclusion, dépression. Ce mal étant considéré comme anormal, il faut le traiter pour que l’individu rentre à nouveau dans la norme. On voit ainsi se développer une course en avant éperdue pour fuir l’angoisse car cette dernière est devenue inexprimable, une plainte empêchée.
Par exemple, l’OMS définit la santé mentale de la façon suivante : « Une personne en bonne santé mentale est donc quelqu’un qui se sent suffisamment en confiance pour s’adapter à une situation à laquelle elle ne peut rien changer.3 » Cette approche positiviste de la santé mentale évacue les fondements de l’existence humaine. L’humanité est tragique par essence. L’angoisse et la souffrance font partie de notre être. En modifiant les fondements philosophiques de la vie, l’OMS crée une normalité d’être inaccessible et, ce faisant, ouvre la voie à une médicalisation de toute anormalité. C’est par exemple ce que l’on observe avec les différentes versions du DSM ou du CIM qui, au fur et à mesure des actualisations, répertorient de plus en plus de troubles psychiques, alors même que nombre d’entre eux, telle qu’une tristesse qui dure plusieurs semaines, relèvent des incidents de la vie. De plus, cette définition postule la nécessaire adaptation aux situations en induisant qu’il faut les accepter plutôt que de vouloir les modifier. Or, de nombreuses situations sociales et organisationnelles sont peu supportables et le minimum éthique est de pouvoir les critiquer, voire de refuser de s’y adapter quand nous considérons qu’elles peuvent être toxiques pour les personnes. Cette définition se préoccupe davantage d’une adaptation des personnes à leur contexte que de leur réelle santé. Cette conception du bien-être résulte de l’influence de la psychologie positive sur la recherche qui vise, même si ce n’était pas son but premier, à «dociliser» les êtres humains. Comme le décrivent Edgar Cabanas et Eva Illouz (2018) « L’industrie du bonheur a pris le pas sur nos vies ». Nous nous devons d’être heureux et pour être heureux il ne faut pas contester mais s’adapter aux contextes.
Plus notable encore cette norme du bien-être conduit, à une fabrication sociale de la souffrance psychique. L’augmentation des troubles psychiques n’est pas répartie de façon équitable dans la société. Les troubles mentaux sont surtout en augmentation dans les classes populaires (Demailly, 2011). De ce fait, ces troubles apparaissent comme résultant du système de société dans lequel nous vivons. Ils résultent d’une construction sociale qui psychiatrise les classes populaires.
Il n’est pas raisonnable d’envisager de supprimer la violence et la souffrance psychique. Proposer de tels fantasmes sociaux revient à nier l’existence de la pulsion de mort inhérente au psychisme humain (De Gaulejac, 1999) et donc produire un mal-être sociétal en empêchant la plainte psychique. Cette plainte empêchée peut provoquer de multiples souffrances.
Le fantasme du bien-être a surtout contribué, au cours des cinquante dernières années, à développer l’individualisme (Cabanas & Illouz, 2018) ; à promouvoir un sentiment d’insécurité, de vide existentiel et à exacerber le narcissisme (Cederström, 2018). Combiné aux pratiques managériales récentes, il conduit également à une insécurisation psychique et à une précarisation subjective (Linhart, 2011).
Il importe alors de garder à l’esprit la dimension sociale de nos élaborations psychiques et de reconnaître qu’elles donnent du sens à notre vie. Comme le souligne Mathieu Bellahsen, (2014, pp. 97-98) : « les épreuves de la vie, les souffrances, les folies, les moments de décompensation et d’effondrement peuvent agir comme des réorganisateurs de vie. »
Déplacer la focale du psychologique vers le social
La logique managériale du bien-être pousse sur le devant de la scène le psychisme individuel. Comme si, le psychisme était suspendu hors contexte et ne subissait pas l’influence du Réel. Cette omission conduit à attribuer la responsabilité du bien-être ou du mal-être à des conditions uniquement intra-personnelles. Cette logique évacue la question des relations de pouvoir qui peuvent induire du mal-être. Ce faisant on individualise des troubles qui sont probablement d’origine sociétale (Bellahsen, 2014). C’est ainsi que nous pourrions comprendre la montée des burnouts ou la «mode» des suicides en milieux professionnels. Il ne s’agirait pas tant du constat d’une fragilité des Moi que d’une pression professionnelle de moins en moins supportable.
Il apparaît alors plus pertinent d’inverser le raisonnement et de postuler que le mal-être, plutôt que de résulter de processus psychiques, constitue le symptôme de l’expérience quotidienne dans les contextes de travail. Ainsi, il serait plus aisé de comprendre pourquoi les premiers de la classe se révoltent (Cassely, 2017) ou certains cadres se rebellent (Courpasson & Thoenig, 2008). Cela permettrait également de comprendre pourquoi les arrêts pour psychopathologie flambent en Allemagne ou l’absentéisme explose en France.
Comme le décrit Michel Feynie (2012) face à l’impossibilité d’être parfaits pour répondre aux injonctions managériales de nombreux salariés développent un syndrome d’imposteur oubliant que la dynamique organisationnelle dans laquelle ils baignent constitue une « fabrique d’imposteurs » (Gori, 2015) car, face à la montée des contraintes et des paradoxes (Bouilloud, 2012), la seule façon de s’en sortir c’est de tricher pour afficher les résultats attendus, même si l’affichage est très déconnecté de la réalité des faits. Or, cet écart entre l’affichage et l’expérience vécue est générateur de mal-être, surtout quand le contexte incite à l’excellence et à la perfection.
Peut-être le temps est-il venu de renoncer à l’idéologie de la performance (Heilbrunn, 2004) afin d’éviter les coûts sociétaux qu’engendre l’excellence (Aubert & de Gaulejac, 2007). Cela pourrait se faire par exemple en intégrant les externalités psychiques négatives dans la conception des organisations du travail en se posant la question, à chaque nouveau changement organisationnel, quels vont être ses coûts psychiques. Une autre option pourrait être de moins protocoliser la GRH mais de s’efforcer de construire du lien social, de mettre de la vie dans les entreprises. Cela pourrait également commencer par modifier certains enseignements dans la formation des managers qui induisent de fausses représentations du fonctionnement humain. Deux exemples parmi les plus connus : Mayo et l’école des relations humaines dont on sait depuis plus de trente ans que d’une part il n’a jamais mis les pieds dans l’usine de Hawthorne et que d’autre part, l’expérimentation menée par Dickson décrivait des résultats quasiment opposés de ceux que Mayo a diffusés. Ou encore, mais cela est maintenant bien connu, Maslow dont on sait, qu’il n’a jamais fait de pyramide (Bridgman et al., 2019).
Alors que nous savons que notre planète est en danger, il est temps d’aborder de façon tenant davantage compte de leur complexité, les questions humaines dans les organisations. Pourquoi ne pas sortir de l’idéologie du bonheur pour redonner toute sa place au sentiment de finitude et aux angoisses qui l’accompagnent mais qui font de nous des êtres réellement humains ?
1 https://www.ayming.fr/typo3conf/ext/almacg/user_upload/Performances_rh/Documents_a_telecharger/Barometre_de_l_Absenteisme_2018.pdf
2 https://www.institutsapiens.fr/le-cout-cache-de-labsenteisme-au-travail-108-milliards-e/
Références
- Aubert N., de Gaulejac V. (1991), Le coût de l’excellence, Seuil.
- Bellahsen M. (2014), La santé mentale – Vers un bonheur sous contrôle, La fabrique éditions.
- Bouilloud J-P. (2012), Entre l’enclume et le marteau – Les cadres pris au piège,
- Bridgman T., Cummings S., Ballard J. (2019), Who Built Maslow’s Pyramid? A History of the Creation of Management Studies’ Most Famous Symbol and Its Implications for Management Education, Academy of Management Learning & Education, Vol. 18, No. 1, 81–98.
- Cabanas E., Illouz V. (2018), Happycratie, Premier parallèle.
- Cassely J-L. (2017), La révolte des premiers de la classe, ARKHE Editions.
- Cederström C. (2018), The happiness fantasy, Polity.
- Cederström C., Spicer A. (2016), Le syndrome du bien-être, L’Echappé.
- Courpasson D., Thoenig J-C. (2008), Quand les cadres se rebellent, Vuibert.
- Demailly L. (2011), Sociologie des troubles mentaux, La Découverte.
- Feynie M. (2012), Le «As if» management – Regard sur le mal-être au travail, Les bords de l’eau.
- de Gaulejac V. (1999), L’Histoire en héritage – Roman familial et trajectoire sociale, Desclée de Brouwer.
- Gori R. (2015), La fabrique des imposteurs, Actes Sud Editions.
- Heilbrunn B. (dir.) (2004), La performance une nouvelle idéologie ?, La Dispute.
- Linhart D. (2011), Une précarisation subjective du travail ?, Réalités Industrielles, Février 2011, pp. 27-34.
- Vandevelde Rougale A. (2017), La novlangue managériale – Emprise et résistance, Eres.
Par Christophe VIGNON, Maître de conférences à l’IGR-IAE de Rennes, membre du CREM (Centre de Recherche en économie et management) UMR CNRS 6211, membre fondateur du groupe de recherche POTES (Psychanalyse Organisation Travail et Société) dans le cadre de l’AIMS (Association Internationale du Management Stratégique). Après avoir longtemps travaillé sur le Management des ressources humaines dans la grande distribution, mes travaux portent actuellement sur l’incarnation éthique des managers, la pédagogie du management et sur les apports de la psychanalyse pour comprendre les phénomènes organisationnels.