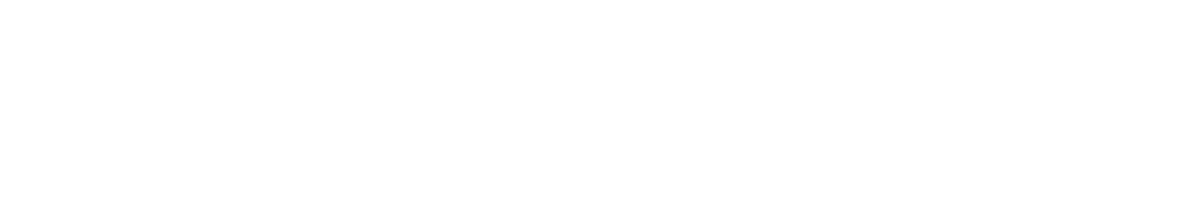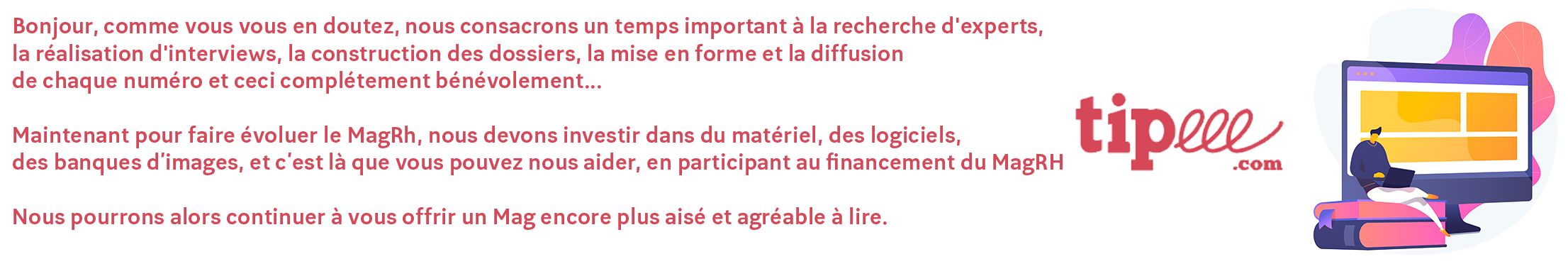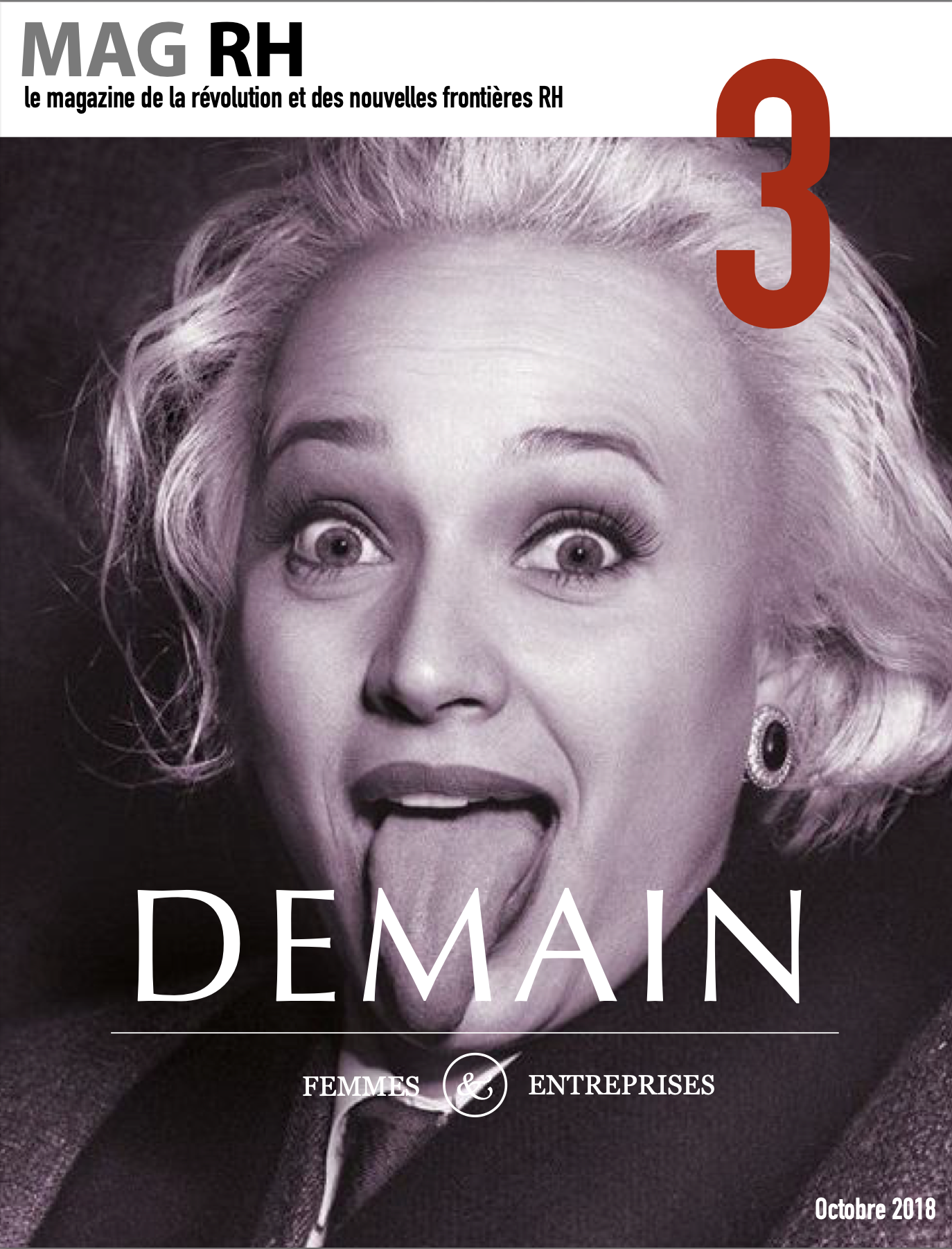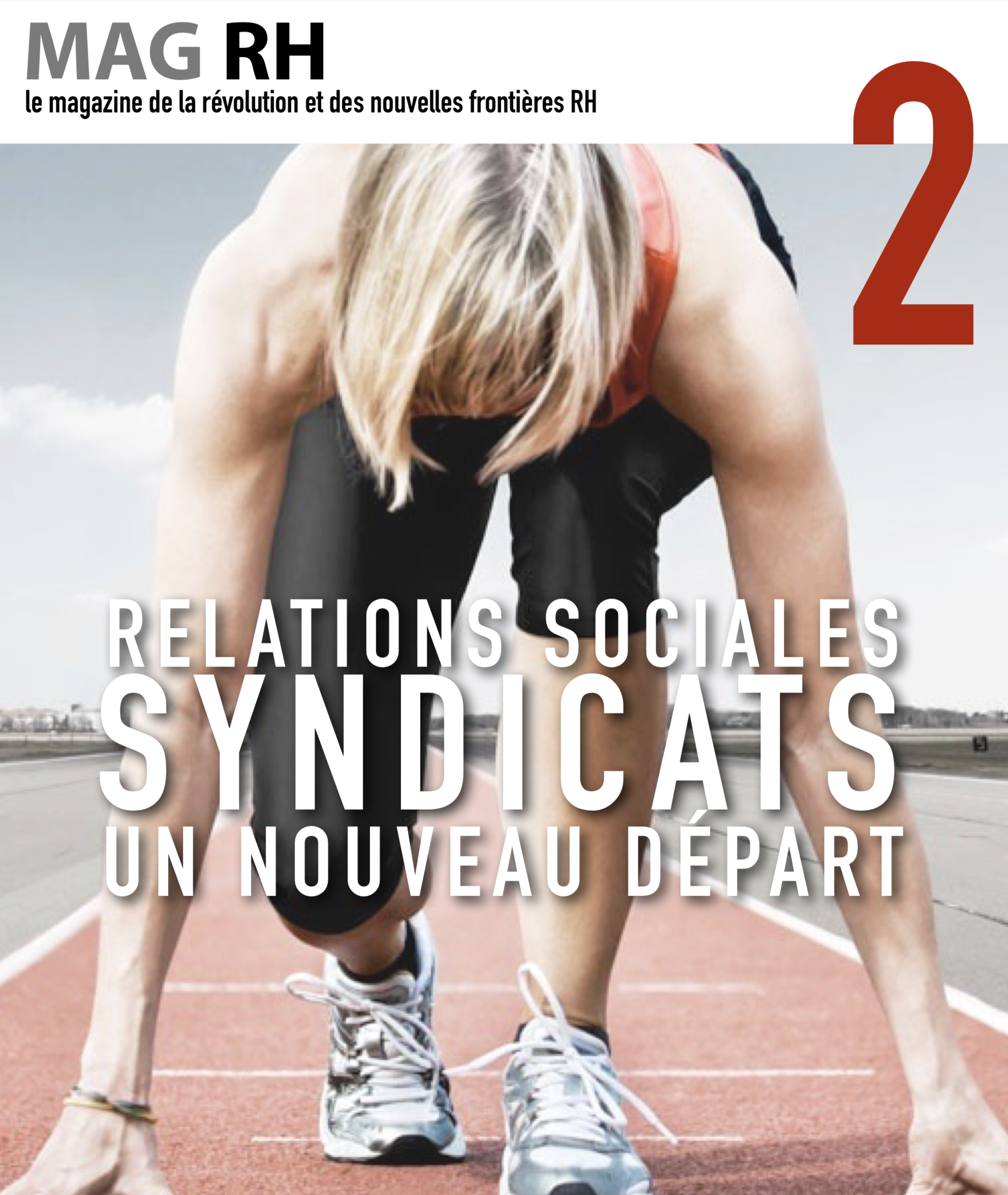Par Martin RICHER est consultant en Responsabilité Sociale des Entreprises. Fondateur de Management & RSE
La RSE est un objet théorique ancré dans les sciences de gestion. Son demi-frère, le développement durable, est né au sein des sciences du vivant. L’une comme l’autre font rarement incursion dans le débat public. C’est pourtant ce qui s’est produit en 2018 et 2019 avec la concertation et la controverse qui ont entouré la réalisation du rapport Notat – Senard puis le vote de la loi PACTE.
Remis au gouvernement le 9 mars 2018 par Nicole Notat, présidente de la société de notation Vigeo-Eiris et Jean-Dominique Senard, à l’époque président du groupe Michelin, le rapport sur « L’entreprise, objet d’intérêt collectif » a relevé le défi d’affronter la grande défiance que les citoyens français adressent à leurs grandes entreprises (voir : « L’entreprise en 2019 : la disruption ou la détestation ! » http ://management-rse.com/2019/02/19/lentreprise-en-2019-la-disruption-ou-la-detestation/). Si cette défiance s’adresse aux grandes entreprises alors que les TPE et PME font au contraire l’objet de jugements positifs, c’est bien que les premières apparaissent « hors-sol », indifférentes à leur écosystème, alors que les secondes sont insérées dans des relations de proximité avec leurs parties prenantes, notamment leur territoire et leurs salariés.
Les solutions proposées par le rapport (qui formule 14 propositions très concrètes) convergent vers l’idée de renouer le lien entre la grande entreprise et la Société qui l’entoure : redonner le primat au long terme, ancrer l’entreprise dans ses écosystèmes, mieux partager la valeur.
En surplomb de ces objectifs apparaît la « mère des batailles » : redéfinir la finalité de l’entreprise. Les auteurs y parviennent de façon très pédagogique et j’incite toute personne intéressée par l’entreprise et n’ayant pas franchi le pas à télécharger ce rapport sans attendre (https ://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/entreprise_objet_interet_collectif.pdf).
En s’attaquant à cette question, le rapport aborde des questions simples mais fondamentales comme « à quoi sert l’entreprise ? », « à qui appartient-elle ? », « qui a voix au chapitre pour lui donner ses orientations et les contrôler ? »… autant de questions éminemment politiques dont je sais la complexité pour avoir travaillé avec l’équipe multidisciplinaire du Collège des Bernardins, qui laboure ce terrain depuis 2009.
Ces questions fondamentales, recouvertes par les cendres de la période de financiarisation ouverte au début des années 1980, réapparues dans la suite de la crise de 2008, ont enfin pu être posées et au-delà du cercle restreint d’universitaires et de juristes qui n’ont pas voulu voir s’éteindre la flamme allumée par les initiatives de François Bloch Lainé (« Pour une réforme de l’entreprise », 1963), d’Antoine Riboud (« Rapport présenté aux Assises du CNPF à Marseille », 1972), de Pierre Sudreau (« La réforme de l’entreprise », 1975), de Jean Auroux (1982), d’Antoine Riboud encore (« Modernisation, mode d’emploi », 1987). En cette fin 2018 et dans l’année qui a suivi, le débat a eu lieu, bien sûr à l’Assemblée nationale (plus de 180 heures de débat sur la loi PACTE) et au Sénat, mais aussi au sein de Conseils d’administration et de Comex qui se sont emparés de la problématique, au sein des écoles de management alors que séminaires et colloques se multipliaient.
Paradoxalement, seul le patronat est resté sur sa réserve tout au long de cette période… avant que Geoffroy Roux de Bézieux, fraîchement élu président du Medef (juillet 2018) ne décide de se tourner vers l’avenir en allant jusqu’à proclamer dans ce moment d’enthousiasme, que son organisation allait se doter d’une raison d’être.
Que reste-t-il de ce débat aujourd’hui ? La conception de l’entreprise en est-elle réellement changée ?
« Tout ça pour ça, » est-on tenté de répondre en première analyse. Je ne suis pas le seul à avoir été heurté par la pauvreté des arguments mis en avant par les opposants à la redéfinition des finalités de l’entreprise, gravées dans le marbre du Code civil et restées intouchées depuis… 1804 (voir : « Appel collectif de soutien aux conclusions du Rapport Notat Senard sur l’entreprise et l’intérêt général » http ://management-rse.com/2018/03/29/appel-collectif-de-soutien-aux-conclusions-rapport-notat-senard-lentreprise-linteret-general/). Il s’agissait d’entériner une reformulation de l’article 1833 de ce code, qui officialise la prise en considération par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité (formulation du rapport Notat-Senard, repris presque à l’identique par la loi PACTE).
Ce n’est pas une révolution copernicienne ; cela consiste plutôt à remettre le droit en ligne avec les pratiques de management d’aujourd’hui. Et pourtant, lors du débat au Sénat, qui a rejeté l’article 61 (sur les finalités de l’entreprise) en février 2019, le sénateur Jean-Marc Gabouty (RDSE, Haute Vienne) a affirmé que les sociétés ont comme seul objet de « produire des biens et des services, pas de faire de la philosophie », si bien que penser à la raison d’être de leur entreprise serait « l’expression d’un état dépressif » du dirigeant… (pour les détails, voir : Loi PACTE : le couronnement de la RSE)/).
Derrière le caractère pathétique de ces arguments, se profile le débat fondamental, qui a opposé Howard Bowen, que je considère comme le fondateur de la RSE (auteur de « Social Responsibilities of the Businessman », 1953) et l’économiste néo-libéral Milton Friedman selon lequel « la responsabilité sociale de l’entreprise est de maximiser ses profits » (titre de son fameux article publié dans « The New York Times Magazine » en septembre 1970), « toute autre considération étant soit immorale soit anti-économique ». Depuis cette époque, la succession de crises financières, la montée des risques globaux (accroissement des inégalités,…), l’aggravation du réchauffement climatique et des pertes irréversibles de biodiversité ont concrétisé l’idée qu’une entreprise ne peut réussir contre ses parties prenantes (voir : « Les parties prenantes, le biocarburant des nouveaux business models » Consulter).
Par ailleurs, la formulation préconisée par le rapport, consistant à ajouter un alinéa à l’article 1833 du Code civil pour indiquer que « la société doit être gérée dans son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (formulation reprise par la loi Pacte qui y a ajouté la notion d’intérêt social) est de portée juridique faible (« en considérant » n’engage pas à réussir !) et ne fait que reconnaître la réalité des pratiques des entreprises en France et l’approche constante de la jurisprudence, notamment depuis le rapport Viénot (1995).
De surcroît, cette obligation (de même que l’intérêt d’inscrire sa raison d’être dans ses statuts) apparaît limitée dans la mesure où le risque de contestation de la politique RSE par des actionnaires (activistes ou non) reste très théorique en France. La situation est différente aux États-Unis où un actionnaire peut attaquer en justice un dirigeant pour contester une décision ayant pour effet de limiter la rentabilité de son investissement (fiduciary duties).
En France, aucun dirigeant n’a jamais été poursuivi pour avoir consacré une partie des ressources de l’entreprise à l’augmentation des salaires, à l’amélioration des conditions de travail ou au respect de l’environnement. Bref, la loi PACTE se situe clairement en retrait de l’ambition initialement affichée par le Président de la République en octobre 2017, lorsqu’il appelait à « changer la philosophie de ce qu’est l’entreprise » (voir : « Ré-encastrer l’Entreprise dans la Cité : une analyse du rapport Notat-Senard » Consulter).
Mais par ailleurs, l’intérêt de toiletter le Code civil inchangé depuis 1804 sur la définition de la société est incontestable. Avant la loi PACTE, celle-ci n’était définie que comme un simple rassemblement d’actionnaires, ce qui est la négation du projet collectif que représente l’entreprise. Pouvait-on sérieusement rester engoncés dans une conception de la société figée à une époque où n’existaient ni les syndicats, ni les associations de consommateurs, ni les marchés financiers, ni le management, ni la mondialisation ?
Certes, la loi n’est pas allée assez loin ; elle continue à ignorer la notion d’entreprise (pour rester prudemment centrée sur l’enveloppe juridique qu’est la société) mais au moins, notre pays n’est pas resté inerte face à ceux qui nous entourent (notamment les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l’Italie), qui ont significativement fait avancer leur droit dans le sens d’une modernisation de l’entreprise.
Le fait d’affirmer, avec la consécration de la notion d’intérêt social, que (pour reprendre les termes de l’exposé des motifs de la loi PACTE), « une société n’est pas gérée dans l’intérêt de personnes particulières, mais dans son intérêt autonome et dans la poursuite de fins qui lui sont propres » confère à la société des attributs de l’entreprise. Même si la portée juridique de cette évolution est avant tout symbolique, dans un pays comme le notre, les symboles comptent !
Sur le plan du management, cette nouvelle approche de l’entreprise ouvre la voie à une meilleure prise en compte de la notion de performance globale (économique, sociétale et environnementale) et à une meilleure insertion des parties prenantes internes et externes au projet de l’entreprise, par le biais des concepts de raison d’être et de société à mission (voir : « Formuler et déployer sa raison d’être Consulter).
Finalement, la cohérence du rapport Notat-Senard et de la loi Pacte réside dans le continuum de formalisme qu’elle induit (les « 3 étages de la fusée »), issu d’une construction pragmatique effectuée tout au long du débat parlementaire :
- Prendre en considération son impact social et environnemental, une obligation qui s’impose à toute entreprise (quelle que soit sa taille, son statut, sa forme juridique et sa maturité sociétale et environnementale) mais dont le caractère transformatif est limité et dont la traduction dans les comportements s’effectuera à géométrie très variable.
- Formuler et déployer sa raison d’être, une approche optionnelle qui amène à formaliser la nature de ces enjeux sociaux et environnementaux auxquels l’entreprise entend contribuer et à s’engager vis-à-vis de ses parties prenantes internes et externes.
- Adopter la qualité de société à mission, une approche également optionnelle, qui suppose une déclinaison de la raison d’être en objectifs intégrés aux statuts et régulés par un dispositif précis.
Ces trois niveaux ne reflètent pas nécessairement l’intensité de l’engagement RSE, mais plutôt le degré de formalisme juridique et de protection statutaire recherché par l’entreprise vis-à-vis de ses actionnaires. Ensemble, ils fournissent une colonne vertébrale autour de laquelle les politiques RSE peuvent désormais se structurer ainsi qu’une réelle dynamique de progrès.