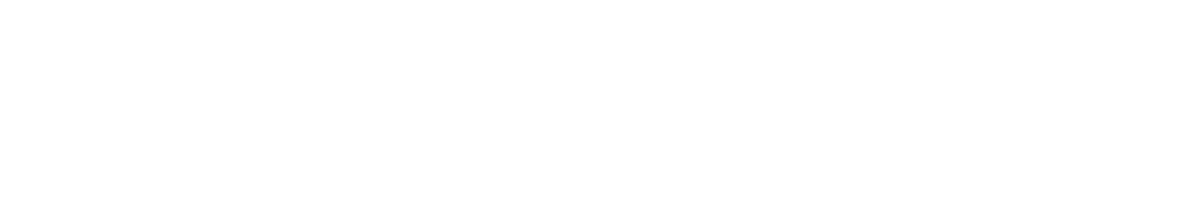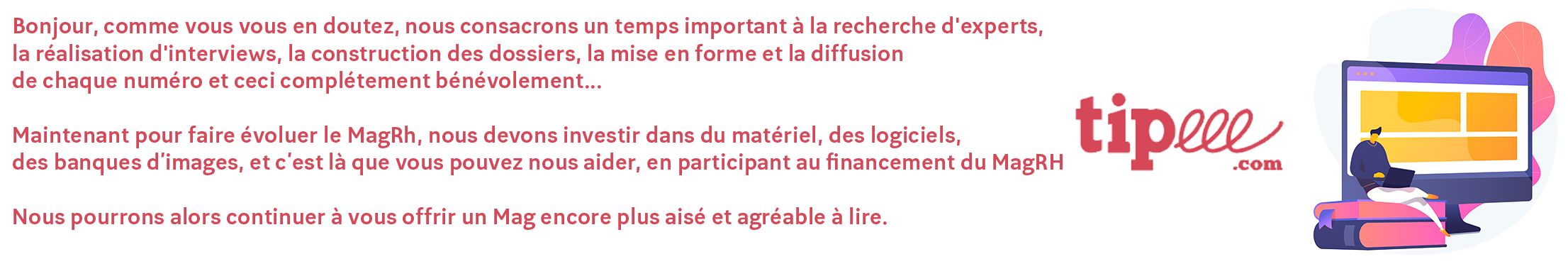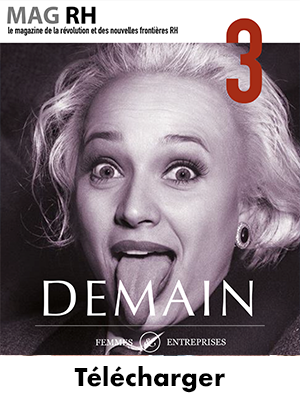Hubert Landier
Il y a longtemps déjà, m’arrêtant à Hamamatsu, venant de Tokyo et me rendant à Kyoto, je tombai en arrêt, dans le hall de la gare, sur un spectacle à l’époque insolite. Un piano (bien entendu, un piano Yamaha puisque Hamamatsu en est le siège) qui jouait tout seul la Lettre à Elise. Ce n’était pas un simple enregistrement : les touches se levaient et s’abaissaient toutes seules, comme si elles avaient été actionnées par un pianiste invisible.
Spectacle qui peut paraître aujourd’hui banal. N’importe quel synthé peut être programmé de façon à jouer un air de musique. Et l’on pourrait donc imaginer que plusieurs synthés, programmés selon un même tempo, pourraient interpréter un air de musique de chambre. Steve Reich, le compositeur minimaliste (quoi qu’il dise) auquel on doit Music for 18 musicians, s’y est essayé. Hé bien, ça ne marche pas ! Quelle que soit la précision des algorithmes, les instruments ne parviennent pas à s’accorder. Il n’y a pas d’autre moyen que de rassembler des musiciens afin de parvenir à une véritable musique. C’est de leur coordination que résulte l’harmonie - et l’intelligence artificielle doit s’incliner devant l’intelligence humaine. Allons plus loin, la « musique relaxante » américaine, automatiquement composée, dont les sons peuvent s’enchaîner durant des heures, ne vaudra jamais un prélude de Debussy. Au moins en l’état actuel de la technique. Et il n’y a aucune raison que ça change.
Encore faut-il que les musiciens sachent jouer. Cela suppose de leur part une parfaite maîtrise de leur instrument. Mais ce n’est pas suffisant. Il leur faut également s’accorder avec les autres musiciens qui composent l’orchestre. C’est ce qui s’appelle la compétence. La compétence a donc deux composantes. Une composante individuelle : la maîtrise de son art. Et une composante collective : se couler dans un ensemble. Et cette double compétence sera toujours supérieure au jeu des algorithmes. Reste à la préserver. Et pour la préserver, de savoir ce qui contribue à l’anéantir.
Hannah Arendt et la condition de l’homme moderne
La grande philosophe allemande, élève de Heidegger et de Husserl, s’interroge sur l’homme moderne, à la fois comme consommateur et comme producteur. Son fil conducteur, c’est la crainte qu’il cesse d’être maître de sa destinée et le risque de voir se constituer un « soft totalitarism ». De l’homme en tant que consommateur, son analyse rejoint celle de Günther Anders, dont elle fut d’ailleurs la première épouse. On se contentera ici de ses propos concernant l’homme en tant que producteur. Et d’abord, on en proposera deux larges citations qui, quoique écrites en 1958, ont gardé toute leur pertinence, qui s’est même accrue avec l’émergence du numérique :
« …Parmi les principales caractéristiques de l’époque moderne, depuis ses débuts jusqu’à nos jours, nous trouvons les attitudes typique de l’homo faber : l’instrumentalisation du monde, la confiance placée dans les outils et la productivité du fabricant d’objets artificiels ; la foi en la portée universelle de la catégorie de la fin-et-des-moyens, la conviction que l’on peut résoudre tous les problèmes et ramener toutes les motivations humaines au principe d’utilité ; la souveraineté qui regarde tout le donné comme un matériau et considère l’ensemble de la nature ‘’comme une immense étoffe où nous pouvons tailler, pour le recoudre comme il nous plaira” ; l’assimilation de l’intelligence à l’ingéniosité, c’est à dire le mépris de toute pensée… ».
Et elle ajoute un peu plus loin : « … Dès à présent, le mot travail est trop noble, trop ambitieux, pour désigner ce que nous faisons ou croyons faire dans le monde où nous sommes. Le dernier stade de la société de travail, la société d’employés, exige de ses membres un pur fonctionnement automatique, comme si la vie individuelle était réellement submergée par le processus global de la vie de l’espèce, comme si la seule décision encore requise de l’individu était de lâcher, pour ainsi dire, d’abandonner son individualité, sa peine et son inquiétude de vivre encore individuellement senties, et d’acquiescer à un type de comportement, hébété, ‘’tranquillisé’’ et fonctionnel ».
Reprenons : le travail, tel qu’il est le plus souvent organisé, réduit l’homme à n’être plus qu’un homo faber, faute de pouvoir se comporter en homo sapiens. Il est instrumentalisé et mis au service d’une démarche qui a pour effet de « tailler le monde » au nom du principe d’utilité ; quant à l’intelligence, faute de pouvoir se concentrer sur la finalité de l’action, elle se réduit à un pur algorithme, une simple « ingéniosité ». Ce que Hannah Arendt dénonce, c’est le taylorisme, le travail réduit à la simple exécution machinale d’un geste répétitif, indépendamment du sens que peut lui donner l’homme au travail et dont la fin demeure extérieure et même souvent inconnue de lui. C’est sa subordination à des algorithmes, qui le réduisent à une marionnette que l’on manipule sans même l’en avertir. Mais, au-delà de ce taylorisme et de cette manipulation, ce qu’elle met en cause, c’est « l’instrumentalisation du monde », sa mise au service du projet démiurgique consistant à l’utiliser au service de sa reconstruction « telle qu’il nous plaira », ou plutôt, telle qu’il plaira aux détenteurs du pouvoir.
Ce que propose Hannah Arendt, c’est de dépasser cette conception aliénante du travail pour retrouver le mode d’activité qui permettra à l’intéressé de considérer ce qu’il a produit comme son œuvre, ou comme sa contribution à l’œuvre collective. Cela suppose un renversement de perspective. Le travailleur ne doit pas être un moyen au service d’un résultat qui lui échappe. Son travail est d’abord un moyen par lequel il existe en tant qu’homme. « Je me suis construit en construisant des temples », fait dire Paul Valéry à Eupalinos, l’Architecte. Au-delà des mornes heures de travail qui lui donnent le sentiment de « perdre sa vie à la gagner », il doit pouvoir dire : « ceci est mon œuvre », ou mieux encore : « ceci est notre œuvre ». C’est le personnel du chantier naval participant à la première sortie en mer du paquebot qui vient d’être achevé ou l’équipe de charpentiers venant d’achever le clocher et, dans une ambiance festive associant toute la population, commençant « la tournée du coq ».
« Je me suis construit en construisant des temples »
Comment passer du travail subi (« perdre sa vie à la gagner ») au travail vécu comme une construction de soi et comme contribution à une œuvre commune ? Tel est le problème posé à l’entreprise. On listera d’abord, sans prétendre à l’exhaustivité, les principales approches qui ont été mises en œuvre, souvent avec bonheur, au cours des ces trente dernières années :
- l’élargissement et l’enrichissement des tâches,
- la création de « groupes de progrès », de « groupes d’expression », de « cercles de qualité » et d’équipes autonomes,
- la direction par objectifs (DPO) et la direction participative par objectifs (DPPO) dans le cadre d’un « projet d’entreprise »,
- l’intéressement et la participation aux résultats,
- l’organisation de l’entreprise en tant que « entreprise apprenante » (ou « learning organization »),
- l’entretien annuel et les possibilités d’évolution professionnelle,
- la création d’une « université d’entreprise »,
- le « lean mangement ».
C’est dans ce cadre que prend place la démarche en termes de développement des compétences. Il convient toutefois ici de lever une ambiguïté. La démarche en termes de développement des compétences ne consiste pas seulement en la possibilité, pour chaque salarié, de se former, de progresser dans son métier et, éventuellement, d’évoluer professionnellement, sur un plan hiérarchique ou non, dans un cadre pré-déterminé. Elle consiste également, pour l’entreprise, à concevoir son organisation en fonction des compétences disponibles, à aider chacun à les développer, et à modifier son organisation au fur et à mesure que son capital en compétences se sera développé. Cela suppose :
la mise en oeuvre d’une politique de subsidiarité ne consistant pas seulement à « déléguer » mais à garantir, à chaque niveau d’organisation et dans le cadre du projet commun, une autonomie correspondant aux compétences disponibles,
l’exercice, venant de chacun, de la responsabilité correspondant aux tâches qui lui ont été confiées,
le passage d’une somme de compétences individuelles à une compétence collective dans la cadre de l’équipe de travail premier niveau) et de la coordination entre les équipes (deuxième niveau).
Un tel dispositif vise à développer la performance globale et durable de l’entreprise. Mais il convient de tenir compte de ce que tous les salariés n’envisagent pas de la même manière leur contribution à l’oeuvre commune. Les uns, tout en s’acquittant avec diligence du travail qui leur est confié, n’y verront qu’un simple gagne pain parce qu’ils situent ailleurs ce qui compte vraiment dans leur existence ; d’autres se soucient d’abord de leur sécurité matérielle, d’autres encore de leurs possibilités d’évolution ; on en trouvera qui se montrent soucieux de l’utilité de ce qu’ils font en termes de service public, ou encore, qui aspirent à la perfection dans l’exercice de leur métier, ou qui souhaitent mettre en œuvre des innovations de leur invention. Et d’autres enfin qui attendent de leurs conditions d’emploi un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. L’entreprise, autrement dit, doit se soucier de la diversité des attentes à son égard et donc de ce qu’elle peut attendre de ses collaborateurs, chacun avec sa spécificité personnelle. La démarche en termes de compétences, autrement dit, ne saurait se fonder sur une vision uniforme, et très certainement irréaliste, de la façon dont chacun envisage sa participation à l’œuvre commune.
Une telle uniformité serait revenir à l’illusion d’un algorithme qui s’appliquerait à toutes et à tous, ce que suggèrent les big data. Or, ce serait oublier qu’un fraiseur n’est pas l’équivalent humain d’un autre fraiseur et qu’il a sa dimension propre, ce qui le fait être homme, dans sa singularité. François Dalle, quand il était président de L’Oréal, soumettait les candidats à un poste important à une épreuve redoutable : commenter la peinture abstraite qui se trouvait derrière son bureau. Démarche autrement plus intelligente que celle qui consiste à sélectionner les candidats en fonction de critères compatibles avec un algorithme. Ce risque de réduire l’intelligence à une simple formule mathématique aux résultats reproduisibles demande à être dénoncée comme une atteinte à l’identité humaine. Un algorithme dont Steve Reich nous rappelle le caractère illusoire, sans quoi il aurait appelé son œuvre non pas Music for 18 musicians, mais « Music for 18 instruments »